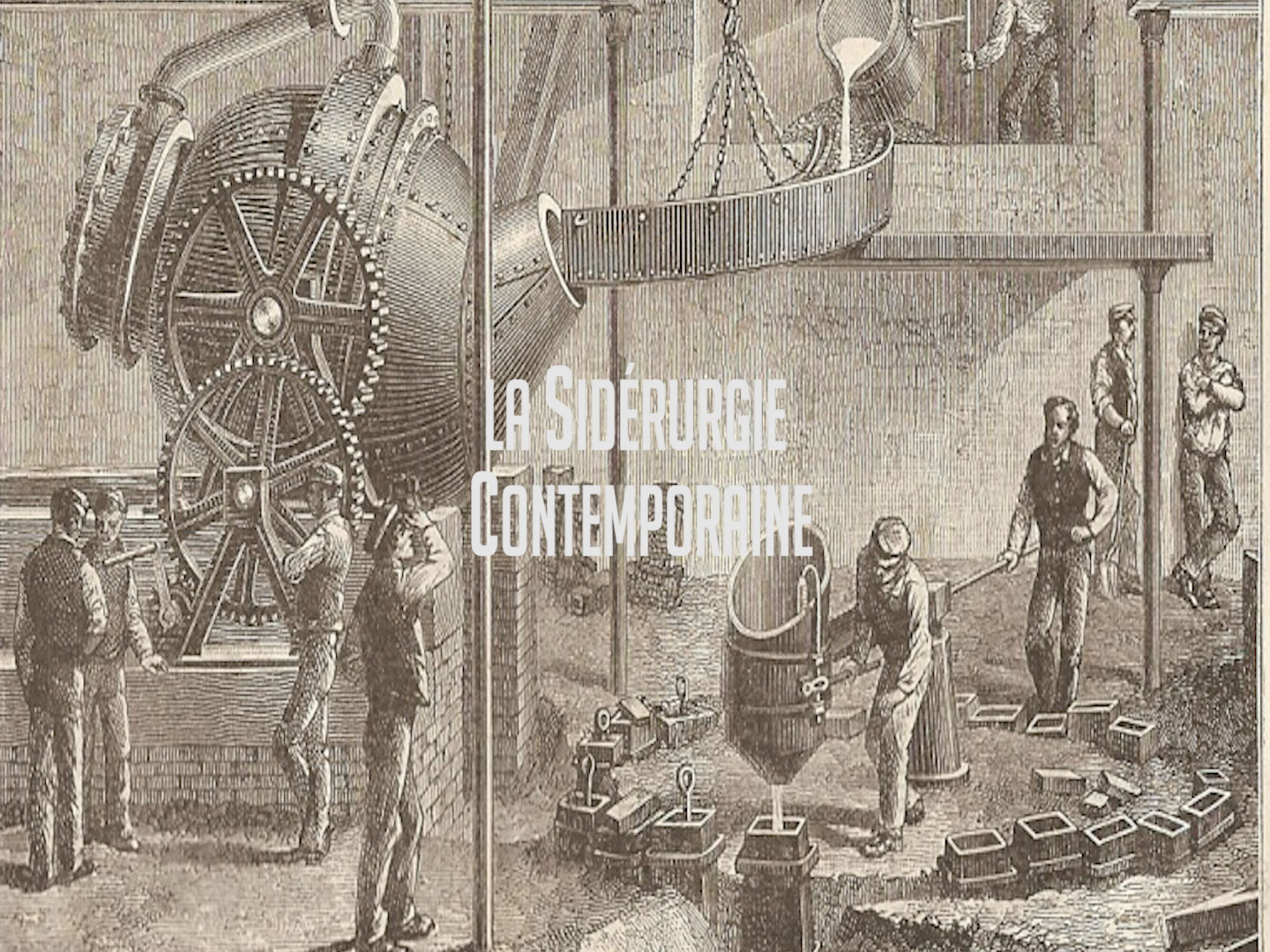1.4.2 Le poids des secteurs anciens : sidérurgie, charbon, textile
Malgré leur importance, leur diversité et un certain renouvellement, les secteurs anciens de l’industrie connaissent un recul relatif et éprouvent inégalement des difficultés, notamment pendant la Grande Dépression et la crise des années trente.
Vieille industrie de base dont le patronat est organisé très tôt dans le puissant Comité des Forges, la sidérurgie connaît tout au long de son histoire une alternance de crises et de recompositions en raison de sa place centrale dans la vie économique et de son caractère d’industrie stratégique. Pendant la période 1880-1914, les nouvelles techniques s’imposent avec le convertisseur d’acier Thomas-Gilchrist qui permet d’utiliser les minerais phosphoreux lorrains, et le four électrique qui permet de produire des aciers spéciaux et des ferro-alliages. De plus en plus scientifiques, ces procédés de fabrication ouvrent la voie à une massification de la production et à une nouvelle répartition de l’activité au profit du quart Nord-Est de la France. Ils facilitent également la mise en place d’une organisation scientifique du travail en aval de la sidérurgie avec l’adoption des aciers à coupe rapide. La croissance de la production d’acier est particulièrement rapide à la belle Epoque avec 1,2 million de tonnes en 1900 et 4,6 en 1913. Les entreprises qui sont des établissements à fort capital fixe se protègent très tôt par des ententes et des cartels par secteurs. Les profits des secteurs nouveaux ou modernisés, comme la production de tubes (Pont-à-Mousson), croissent nettement jusqu’à la guerre[140]. Si la France voit sa production de fonte diminuer de 80% avec l’invasion allemande, le premier conflit mondial accélère la structuration du secteur en consortiums et cartels. Avec la victoire, la France récupère les usines très bien équipées de Lorraine annexée mais ne procède pas à une modernisation systématique. La reconstruction, la prospérité et la croissance d’industries nouvelles comme l’industrie automobile permettent de doubler la production d’acier par rapport à 1913 avec presque 10 millions de tonnes en 1929. Protégée par la création du cartel européen de l’acier en 1926, la France exporte presque le tiers de sa production. Pendant les années trente, la sidérurgie connaît une crise atténuée mais durable. La production d’acier chute à 5,5 millions de tonnes en 1932. Après une reprise en 1937, elle replonge en 1938 à 6,2 millions de tonnes pour remonter en 1939 à presque 8 millions alors que les exportations ont chuté d’environ 40%. Si la sidérurgie n’est pas le « foyer de la crise »[141], elle souffre de la rétractation des marchés. Pourtant les difficultés, qui varient selon les entreprises, sont sans doute amorties par la recréation d’un cartel international dès 1932. Si le chiffre d’affaires de Schneider recule quelque peu, ses bénéfices augmentent. Ce cas n’est pas isolé. Pour Françoise Berger, l’orientation vers la fabrication d’armements d’une partie de la sidérurgie française avant même 1938 peut expliquer cette résistance à la crise.
Loin d’être handicapée par le développement de l’électricité, l’industrie charbonnière conserve sa prééminence dans le domaine énergétique et connaît même un « âge d’or » après la Grande Dépression[142]. Les gisements du Nord - particulièrement ceux du Pas-de-Calais qui bénéficient de bonnes conditions d’exploitation - surclassent les mines du Centre et du Midi en fournissant 67% de la production française en 1913, ce qui permet de limiter l’importation de charbon étranger à un tiers des besoins alors que la consommation française passe de 29 millions de tonnes en 1880 à 65 millions en 1913. Or, comme les grandes compagnies minières doivent verser des dividendes, comme la mécanisation est faible et comme les mines sont tôt ou tard soumises à la loi des rendements décroissants, la seule façon de donner satisfaction aux actionnaires est d’augmenter sans cesse la production. Celle-ci atteint son maximum en 1930 avec 55 millions de tonnes pour des taux de profit de l’ordre de 13%, ce qui contredit une image d’activité peu rentable. Les charbonnages constituent longtemps une « poule aux oeufs d’or » pour le patronat textile de la région lilloise qui les contrôle en grande partie. En revanche, les conditions de travail décrites par Zola dans Germinal se prolongent dans les années 1920 et l’on sait que c’est la catastrophe de Courrières du 10 mars 1906 où périssent 1 099 mineurs qui oblige la CGT à se lancer - sans succès - dans la grève générale. La forte syndicalisation et les premières conventions collectives dont les mineurs sont les premiers à bénéficier ne suppriment pas les souffrances liées au travail tandis que l’importance des besoins en main-d’oeuvre de la mine ne favorise pas l’implantation d’autres activités industrielles susceptibles de proposer des emplois alternatifs. Aussi le bassin houiller, notamment dans le Pas-de-Calais, connaît-il une « croissance sans développement » qui handicape lourdement l’avenir. Dès les années 1900, la main d’oeuvre régionale est insuffisante et il faut faire appel à l’immigration. De 6,5% en 1906, les travailleurs étrangers représentent 42% des mineurs en 1931, et, parmi eux, les Polonais dominent de façon écrasante. L’arrivée de cette nouvelle population coïncide avec la recherche d’une organisation rationnelle du travail qui favorise le paiement individuel contre le travail en équipe (système Bedaux) et une mécanisation partielle visant à économiser la main-d’oeuvre avec le marteau-piqueur et le couloir oscillant qui consiste en une ligne de bacs suspendus pour transporter le charbon. Avec la crise des années trente, ententes et cartels, développement de la pression sur la main-d’oeuvre et mécanisation s’accentuent : tout est fait pour comprimer les coûts. Les premiers à souffrir de la situation sont les ouvriers étrangers renvoyés en masse et sans ménagements.
☖ Un nouveau champ, l’histoire des risques industriels
Les explosions de poudrières comme celle de Delft aux Pays-Bas (1654) qui fait une centaine de morts jalonnent l’histoire urbaine moderne et contemporaine.Au XIXe siècle, les accidents miniers tuent plus encore.
La catastrophe de Courrières qui fait 1099 morts a profondément marqué les mémoires.
Depuis les années 1960-70, quelques accidents très graves et très médiatisés, comme l’explosion de la raffinerie de Feyzin (1966), ont ému l’opinion publique et suscité l’intervention de l’Etat. L’existence de risques permanents liés à l’activité humaine ne peut plus être niée ou négligée.
De plus, risques technologiques et professionnels, risques industriels et risques naturels ont été rapprochés au point que l’on a parlé de « société du risque »[1].
Avec un certain retard par rapport à d’autres sciences humaines comme la sociologie et l’anthropologie, l’histoire s’est intéressée à ce nouveau champ. Appuyée sur l’histoire de l’environnement, celle des risques naturels et celle de la pollution industrielle, l’histoire des risques industriels s’est affirmée. Les historiens ont notamment montré le poids des intérêts économiques et la difficulté d’appréhender la perception des risques par les populations concernées. Ils sont en effet d’autant moins visibles que les industriels font tout pour les invisibiliser.
De plus, l’Etat, en France, a toujours protégé l’industrie. Avant la catastrophe de 1906, la Compagnie de Courrières passait pour une compagnie rigoureuse soucieuse d’améliorer la sécurité des mineurs, mais, en réalité, les aménagements qui poursuivaient d’abord un objectif de rentabilité négligeaient des risques traditionnels tout en en faisant émerger d’autres. Finalement, les historiens ont montré que la perception des risques industriels était très périodisée - chaque époque se focalisant sur un type de risque quitte à occulter les autres - et ils ont souligné le fait que les mesures prises par les entreprises et l’Etat sont plus efficaces pour acclimater les risques industriels que pour les supprimer.
✐ Source : [1] Ulrich Beck, La société du risque, trad. de l’allemand par L. Bernardi. Paris, Aubier, 2001, 521 p.
Ancien secteur pionnier, le textile pèse encore lourd à l’époque de la seconde industrialisation. Sans compter l’habillement, il représente 30% de l’activité industrielle en 1900. Secteur très hétérogène de par les fibres utilisées et les types de productions, cette industrie décline sa diversité à l’intérieur même de chaque sous-secteur et territoire par territoire[143]. Secteur à évolution lente, l’industrie textile fait coexister des formes de production anciennes et modernes, y compris au sein d’une même entreprise. Comme pendant la première industrialisation, le textile constitue une « voie moyenne »[144] dans laquelle des investissements fixes permettent d’employer une main-d’oeuvre à la fois bon marché, habile et très largement féminine. La production consiste assez largement en produits de luxe ou de demi luxe destinés pour partie à l’exportation. Si les grandes entreprises qui restent familiales triomphent, notamment à Roubaix-Tourcoing, le textile est dominé par les PME et le travail à domicile, très mal payé, résiste. Secteur sensible, c’est lui que les consommateurs abandonnent le premier quand des difficultés s’annoncent. La première guerre mondiale réduit le Nord à l’inactivité et aux destructions mais la reconstruction de l’ensemble lainier de Roubaix-Tourcoing lui permet de consolider sa prééminence. Globalement, la production diminue de 40% entre 1913 et 1919 et il faut attendre 1929 pour retrouver le niveau de 1913. La crise des années trente la fait reculer de 30% en moyenne. Dans la soierie, le chiffre d’affaires diminue de 75% entre 1928 et 1936 et ses exportations de 85%[145]. Les évolutions territoriales et sectorielles déjà constatées pendant la période précédente se confirment. Le Nord domine tandis que le Midi tend à s’effacer. Solidement implantée à Roubaix-Tourcoing, la laine occupe la première place alors que le chanvre et le lin disparaissent. Industrie de luxe et d’exportation très sensible aux variations de la mode, la soierie lyonnaise se transforme pour réduire ses coûts en s’orientant vers des productions plus ordinaires, en se mécanisant, en éclatant son territoire de production dans tout l’espace régional et même en utilisant des fibres artificielles dont la production ne cesse d’augmenter.
Notes :
[140] Eric Bussière, Emmanuel Chadeau et Roger Martin, « Sidérurgie et métallurgie lourde : aléas et structures », in Maurice Lévy-Leboyer [dir.], Histoire de la France industrielle, Paris, Larousse, 1996, p. 296-337.
[141] Françoise Berger, La France, l’Allemagne et l’acier (1932-1952). De la stratégie des cartels à l’élaboration de la CECA, Thèse, Paris1, [dir.] René Girault, Robert Frank, 2000, p. 53.
[142] Marcel Gillet, Les charbonnages du nord de la France au XIXe siècle, Paris, La Haye, Mouton, 1973 ; Diana Cooper-Richet, Le peuple de la nuit. Mines et mineurs en France (XIXe-XXIe siècle), Paris, Perrin, 2002, éd. 2011 ; Jean-Luc Mastin, « Concentration dans l’industrie minière et construction de l’espace régional : le cas du Nord-Pas-de-Calais de 1850 à 1914 », Revue du Nord, t. 92, n°387, oct.-déc. 2010, p. 793-812.
[143] Jean-Claude Daumas, Les territoires de la laine…, op. cit.
[144] François Crouzet, « Encore la croissance économique française », in J.-P. Poussou [dir.], L’économie française du XVIIIe au XXe siècle. Mélanges offerts à François Crouzet. Paris, 2000, p. 121-148.
[145] Pierre Vernus, « Soierie lyonnaise et rubannerie stéphanoise », in Fl. Charpigny et B. Dumons, Rhône-Alpes. La construction d’une région, Rennes, PUR, 2015, p. 169-178.